
Les visiteurs sont de plus en plus nombreux dans les monastères, comme simples touristes séduits par la majesté des lieux et des chants, ou pour y séjourner une semaine ou deux, certains s'astreignant même au silence et au confort spartiate.
Qu'ils soient augustins, bénédictins, cisterciens, trappistes (comme l'étaient les moines de Tibéhirine), chartreux ou prémontrés, les moines vivent en communautés et partagent leur temps entre la prière et le travail, la règle voulant qu'ils assurent eux-mêmes leurs moyens d'existence.
Ils sont donc potiers, confiseurs, liquoristes, relieurs, producteurs de fruits et légumes, etc., tout en consacrant de longs moments à la méditation et aux offices et prières. Les moniales (clarisses, carmélites, visitandines) ont le même mode de vie.
La première communauté a été fondée en 315 en Egypte et peu après, en 361, c'est à Ligugé, près de Poitiers, que Martin de Tours (saint Martin), entouré de quelques hommes, s'est retiré du monde, créant le premier monastère d'Europe. Les premiers monastères féminins ont été fondés au XIIe siècle, à l'initiative de Claire d'Assise.
Selon l'hebdomadaire catholique Pèlerin ("50 clés pour comprendre la vie monastique"), il y a actuellement en France 1.400 moines dans 125 monastères et 4.334 moniales dans 273 monastères.
Mère Marie-Chantal Geoffroy, présidente de la Fondation des monastères, expliquait récemment devant la presse que les communautés vieillissent et qu'il faut parfois fermer des établissements. Par exemple, quand une communauté ne compte plus que deux ou trois soeurs âgées, elle est alors rattachée à une autre.
Même chose dans les monastères d'hommes, selon le trappiste Dom Guillaume Jedrzejczak. Comme Mère Marie-Chantal Geoffroy, il estime que la baisse des vocations est liée à l'évolution de la société: "On baigne moins dans un contexte religieux" et on hésite à s'engager définitivement, ou alors pour aller dans les monastères où la règle est la plus stricte (silence absolu, pas de visites, liturgie à l'ancienne, etc.).
En revanche, les hôtelleries des monastères font un tabac.
Mère Marie-Chantal, supérieure du monastère de la Visitation de Voiron (Isère), assure que dans son diocèse les capacités d'accueil des monastères ne suffisent pas à répondre à la demande.
"Nous avons des chrétiens en retraite, des gens qui recherchent une écoute, d'autres, croyants ou pas, qui sont en quête de silence et d'absolu", dit-elle, racontant qu'elle accueille aussi des femmes qui demandent à partager la vie de la communauté dans la clôture pour une semaine ou deux, acceptant aussi de ne parler qu'à une des soeurs de la communauté.
Quand on demande à Dom Guillaume ce qui caractérise la vie monastique, il répond spontanément "la simplicité". Si on lui parle de spiritualité, d'élévation, il répond en riant qu'il apprécie "le va-et-vient entre action et contemplation".
Qu'ils soient augustins, bénédictins, cisterciens, trappistes (comme l'étaient les moines de Tibéhirine), chartreux ou prémontrés, les moines vivent en communautés et partagent leur temps entre la prière et le travail, la règle voulant qu'ils assurent eux-mêmes leurs moyens d'existence.
Ils sont donc potiers, confiseurs, liquoristes, relieurs, producteurs de fruits et légumes, etc., tout en consacrant de longs moments à la méditation et aux offices et prières. Les moniales (clarisses, carmélites, visitandines) ont le même mode de vie.
La première communauté a été fondée en 315 en Egypte et peu après, en 361, c'est à Ligugé, près de Poitiers, que Martin de Tours (saint Martin), entouré de quelques hommes, s'est retiré du monde, créant le premier monastère d'Europe. Les premiers monastères féminins ont été fondés au XIIe siècle, à l'initiative de Claire d'Assise.
Selon l'hebdomadaire catholique Pèlerin ("50 clés pour comprendre la vie monastique"), il y a actuellement en France 1.400 moines dans 125 monastères et 4.334 moniales dans 273 monastères.
Mère Marie-Chantal Geoffroy, présidente de la Fondation des monastères, expliquait récemment devant la presse que les communautés vieillissent et qu'il faut parfois fermer des établissements. Par exemple, quand une communauté ne compte plus que deux ou trois soeurs âgées, elle est alors rattachée à une autre.
Même chose dans les monastères d'hommes, selon le trappiste Dom Guillaume Jedrzejczak. Comme Mère Marie-Chantal Geoffroy, il estime que la baisse des vocations est liée à l'évolution de la société: "On baigne moins dans un contexte religieux" et on hésite à s'engager définitivement, ou alors pour aller dans les monastères où la règle est la plus stricte (silence absolu, pas de visites, liturgie à l'ancienne, etc.).
En revanche, les hôtelleries des monastères font un tabac.
Mère Marie-Chantal, supérieure du monastère de la Visitation de Voiron (Isère), assure que dans son diocèse les capacités d'accueil des monastères ne suffisent pas à répondre à la demande.
"Nous avons des chrétiens en retraite, des gens qui recherchent une écoute, d'autres, croyants ou pas, qui sont en quête de silence et d'absolu", dit-elle, racontant qu'elle accueille aussi des femmes qui demandent à partager la vie de la communauté dans la clôture pour une semaine ou deux, acceptant aussi de ne parler qu'à une des soeurs de la communauté.
Quand on demande à Dom Guillaume ce qui caractérise la vie monastique, il répond spontanément "la simplicité". Si on lui parle de spiritualité, d'élévation, il répond en riant qu'il apprécie "le va-et-vient entre action et contemplation".

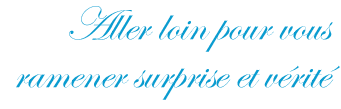







 Accueil
Accueil Actus
Actus
















