
Si les Lois fondamentales antérieures, dont celle de 1996, assignaient à la loi un champ de compétence limité, alors qu’elles attribuaient aux titulaires du pouvoir exécutif une compétence de droit commun, dans le cadre de l’édiction réglementaire, la nouvelle Constitution du 29 juillet 2011, bien que fidèle à ce principe, élargit considérablement le domaine de la loi, qui passe de dix matières à plus de 30. Plus de matières appartiennent ainsi au domaine de la loi, et relèvent donc obligatoirement du vote du parlement, ce qui participe clairement à en renforcer les pouvoirs et à en étendre le champ d’action.
Il n’existe donc en ce domaine aucune soumission de l’exécutif au pouvoir législatif, en termes de hiérarchie des normes, puisque le premier ne permet pas uniquement d’encadrer l’application des textes de loi, issus du vote du parlement, mais également et en toute autonomie, d’exercer le pouvoir réglementaire, en dehors des champs relevant de la loi. Sur ce fondement, il est donc possible pour le pouvoir exécutif d’édicter des règlements sans qu’il n’y ait de loi précise à exécuter. Ainsi il existe au Maroc un pouvoir réglementaire autonome, qui ne se limite pas à la simple application des textes législatifs, votés par le parlement, mais relève des matières n’appartenant pas au domaine de la loi.
Rappelons tout de même que le pouvoir réglementaire, dont le pouvoir réglementaire autonome, appartient conjointement au roi et au chef du gouvernement, et que celui-ci est par définition le pouvoir dont disposent les autorités exécutives de prendre des actes juridiques exécutoires, comprenant des dispositions générales et impersonnelles, et ce, de manière unilatérale, et donc sans l’accord de ceux auxquels s’applique le règlement. L’originalité de la nouvelle Constitution marocaine ne concerne cependant pas le pouvoir réglementaire autonome en lui-même, mais bel et bien sa répartition entre les deux branches de l’exécutif, qui, contrairement aux pratiques en vigueur dans certains Etats, est constitutionnellement déterminée. Ainsi, deux articles distincts de la Constitution énumèrent les matières réglementaires autonomes relevant d’une part, du Conseil des ministres et donc du roi, et d’autre part du Conseil du gouvernement, et donc du chef du gouvernement.
De cette manière, il existe également une distribution réelle des prérogatives réglementaires autonomes entre le chef de l’Etat et le chef du gouvernement, qui procède d’une redistribution équilibrée des pouvoirs opérée par la nouvelle Constitution du pays.
Il n’existe donc en ce domaine aucune soumission de l’exécutif au pouvoir législatif, en termes de hiérarchie des normes, puisque le premier ne permet pas uniquement d’encadrer l’application des textes de loi, issus du vote du parlement, mais également et en toute autonomie, d’exercer le pouvoir réglementaire, en dehors des champs relevant de la loi. Sur ce fondement, il est donc possible pour le pouvoir exécutif d’édicter des règlements sans qu’il n’y ait de loi précise à exécuter. Ainsi il existe au Maroc un pouvoir réglementaire autonome, qui ne se limite pas à la simple application des textes législatifs, votés par le parlement, mais relève des matières n’appartenant pas au domaine de la loi.
Rappelons tout de même que le pouvoir réglementaire, dont le pouvoir réglementaire autonome, appartient conjointement au roi et au chef du gouvernement, et que celui-ci est par définition le pouvoir dont disposent les autorités exécutives de prendre des actes juridiques exécutoires, comprenant des dispositions générales et impersonnelles, et ce, de manière unilatérale, et donc sans l’accord de ceux auxquels s’applique le règlement. L’originalité de la nouvelle Constitution marocaine ne concerne cependant pas le pouvoir réglementaire autonome en lui-même, mais bel et bien sa répartition entre les deux branches de l’exécutif, qui, contrairement aux pratiques en vigueur dans certains Etats, est constitutionnellement déterminée. Ainsi, deux articles distincts de la Constitution énumèrent les matières réglementaires autonomes relevant d’une part, du Conseil des ministres et donc du roi, et d’autre part du Conseil du gouvernement, et donc du chef du gouvernement.
De cette manière, il existe également une distribution réelle des prérogatives réglementaires autonomes entre le chef de l’Etat et le chef du gouvernement, qui procède d’une redistribution équilibrée des pouvoirs opérée par la nouvelle Constitution du pays.

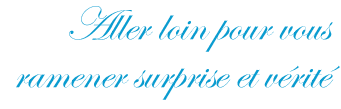







 Accueil
Accueil Actus
Actus
















