
Leila Bekhti
Leur plus grande fierté, expliquent-elles à l'AFP à la veille d'un événement qui sonne pour chaque artiste ou artisan du cinéma comme une consécration, c'est d'aborder le tapis rouge en compagnie d'une douzaine de femmes du village marocain dans lequel elles ont semé la révolution.
Désespérée par la multiplication des fausses-couches chez les femmes de corvée d'eau sur des sentiers escarpés et rocailleux, propices aux chutes, Leila lance la "grève de l'amour" pour obliger les hommes à acheminer l'or bleu jusqu'au village.
Hafsia de son côté rêve encore de contracter un mariage d'amour et de partir en voyage en confiant ses enfants à son futur époux.
Toutes deux ont retrouvé la langue de leurs ancêtres pour ce tournage en arabe, travaillé l'accent et le vocabulaire marocains et suivi de véritables stages avec les femmes de Warielt, village élu à une heure de Marrakech dans la montagne.
"On a travaillé avec les femmes pour en apprendre les gestes du quotidien, laver le linge dans l'oued, cuire le pain, et même à marcher comme elles", raconte Hafsia Herzi, 24 ans, née d'une mère algérienne et d'un père tunisien (décédé quand elle avait 2 ans), benjamine d'une famille de six enfants, grandie à Marseille.
"Ce tournage c'était pour moi comme un retour à la maison, il me faisait penser au village de ma mère", confie-t-elle.
"Pour moi, le contact avec ces femmes, les voir se parler, se toucher, rire, c'était une leçon de vie. L'important était de ne surtout pas les stéréotyper", insiste Leila Bekhti, 27 ans, élevée en banlieue parisienne dans une famille venue d'Oran (Algérie).
"Au départ je pensais à elle en les plaignant: mais elles riaient en racontant que la corvée d'eau qui prenait deux heures, elles la faisaient en trois, pour le plaisir de traîner entre elles".
Hafsia qui hésitait encore vendredi entre deux robes, jaune ou rose, pour la montée des marches, détestait ses costumes de paysanne berbère au départ: "J'avais peur de paraître énorme avec toutes ces jupes et surtout je ne supportais pas de porter une foulard en permanence".
"Après les premiers essayages, Leila m'a dit: +On va être moche+. Mais à l'arrivée, ça va", rit-elle.
Hafsia montera samedi les marches pour la deuxième fois du festival, ayant déjà accompagné cette semaine "L'Apollonide", autre film français en compétition de Bertrand Bonello, où elle figure une pensionnaire d'une maison close à la veille du XXè siècle.
Pour Leila aussi, ce sera une seconde fois après son premier tapis rouge cannois en 2009 pour "Un Prophète" de Jacques Audiard (Grand Prix du jury), au côté de l'acteur Tahar Rahim, devenu son mari depuis.
Hormis "quatre ulcères et six sciatiques de peur de plein de choses, de pas être à la hauteur", la jeune femme se réjouit d'avance de la réaction des invitées berbères: "Elles monteront devant nous, on les applaudira, on les prendra en photo. C'est la première fois qu'elles quittent leur village, leur première fois au cinéma, la première fois qu'elles vont se voir sur un grand écran... que vont elles raconter en rentrant chez elle?".
Désespérée par la multiplication des fausses-couches chez les femmes de corvée d'eau sur des sentiers escarpés et rocailleux, propices aux chutes, Leila lance la "grève de l'amour" pour obliger les hommes à acheminer l'or bleu jusqu'au village.
Hafsia de son côté rêve encore de contracter un mariage d'amour et de partir en voyage en confiant ses enfants à son futur époux.
Toutes deux ont retrouvé la langue de leurs ancêtres pour ce tournage en arabe, travaillé l'accent et le vocabulaire marocains et suivi de véritables stages avec les femmes de Warielt, village élu à une heure de Marrakech dans la montagne.
"On a travaillé avec les femmes pour en apprendre les gestes du quotidien, laver le linge dans l'oued, cuire le pain, et même à marcher comme elles", raconte Hafsia Herzi, 24 ans, née d'une mère algérienne et d'un père tunisien (décédé quand elle avait 2 ans), benjamine d'une famille de six enfants, grandie à Marseille.
"Ce tournage c'était pour moi comme un retour à la maison, il me faisait penser au village de ma mère", confie-t-elle.
"Pour moi, le contact avec ces femmes, les voir se parler, se toucher, rire, c'était une leçon de vie. L'important était de ne surtout pas les stéréotyper", insiste Leila Bekhti, 27 ans, élevée en banlieue parisienne dans une famille venue d'Oran (Algérie).
"Au départ je pensais à elle en les plaignant: mais elles riaient en racontant que la corvée d'eau qui prenait deux heures, elles la faisaient en trois, pour le plaisir de traîner entre elles".
Hafsia qui hésitait encore vendredi entre deux robes, jaune ou rose, pour la montée des marches, détestait ses costumes de paysanne berbère au départ: "J'avais peur de paraître énorme avec toutes ces jupes et surtout je ne supportais pas de porter une foulard en permanence".
"Après les premiers essayages, Leila m'a dit: +On va être moche+. Mais à l'arrivée, ça va", rit-elle.
Hafsia montera samedi les marches pour la deuxième fois du festival, ayant déjà accompagné cette semaine "L'Apollonide", autre film français en compétition de Bertrand Bonello, où elle figure une pensionnaire d'une maison close à la veille du XXè siècle.
Pour Leila aussi, ce sera une seconde fois après son premier tapis rouge cannois en 2009 pour "Un Prophète" de Jacques Audiard (Grand Prix du jury), au côté de l'acteur Tahar Rahim, devenu son mari depuis.
Hormis "quatre ulcères et six sciatiques de peur de plein de choses, de pas être à la hauteur", la jeune femme se réjouit d'avance de la réaction des invitées berbères: "Elles monteront devant nous, on les applaudira, on les prendra en photo. C'est la première fois qu'elles quittent leur village, leur première fois au cinéma, la première fois qu'elles vont se voir sur un grand écran... que vont elles raconter en rentrant chez elle?".

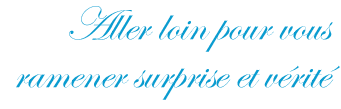







 Accueil
Accueil Actus
Actus
















