
Dans son discours du 3 janvier 2010, le Roi Mohammed VI a annoncé la mise en place d’une Commission consultative de la régionalisation (CCR) dans le but de donner un cadre institutionnel aux réflexions et aux débats autour de ce grand chantier. Dans ce discours, le Roi a tenu à préciser que ce projet n’est pas un simple réaménagement territorial ou administratif, mais qu’il s’agit plutôt d’un véritable chantier de réforme visant à rénover et à moderniser l’organisation territoriale de l’Etat. La CCR a présenté ses conclusions au souverain en mars 2011. Avec le lancement de ce grand chantier de régionalisation avancée, le Maroc effectue un pas historique sur la voie des réformes et de la modernisation de son architecture administrative et territoriale.
Aboutissement d’un long processus de décentralisation initié au Maroc au lendemain de l’indépendance, la régionalisation avancée constitue un choix stratégique irréversible qui met le citoyen au centre des préoccupations de l’Etat. Elle constitue un tournant majeur dans les modes de gouvernance territoriale au Maroc. Le projet de la régionalisation avancée vise à renforcer la représentativité des citoyens dans les conseils régionaux et à mettre en place des mécanismes à même d’instaurer une véritable démocratie participative. Cette dernière ne se limite nullement au droit de vote prévu périodiquement, mais elle désigne les dispositifs juridiques et institutionnels permettant d’impliquer les citoyens dans la gestion des affaires locales et, par conséquent, d’influer sur le processus de prise de décision au niveau de la région.
En ce sens, il convient de souligner que la démocratie participative est envisagée dans le cadre de la régionalisation avancée à deux niveaux. Il s’agit tout d’abord, d’une participation directe des citoyens, et ensuite d’une participation du tissu associatif. Le premier niveau se traduit par l’implication directe des citoyens dans le choix de leurs représentants dans les instances élues. Le second niveau appréhende le tissu associatif comme une véritable force de proposition, de veille et d’interpellation auprès des instances élues. En outre, ces acteurs associatifs participeront à la promotion de la culture de la démocratie locale et à la réalisation de projets de développement régionaux.
Mais cette implication passe par un renforcement des capacités de ces associations et par la mise à leur disposition des moyens matériels nécessaires. De plus, la CCR préconise l’adoption de dispositifs consultatifs qui permettront d’organiser l’expression des besoins et des attentes des citoyens en ce qui concerne les questions qui affectent leur vie quotidienne. Ainsi, un mécanisme de dialogue et de concertation avec le tissu associatif sera mis en place dans la perspective d’optimiser sa participation dans le processus de prise de décision au niveau régional. De surcroît, un cadre de référence définissant les principes, conditions et modalités de partenariat avec les associations a été mis en place par la CCR. Il faut ajouter que l’implication des forces sociales dans la gestion des affaires locales ne se limite pas seulement à la participation dans le processus de prise de décision mais se traduit également par l’exercice d’un droit de pétition. Ce dernier constitue un véritable contrôle populaire sur les conseils régionaux. Ce droit de pétition permet aux citoyens d’inscrire à l’ordre du jour du conseil, une question relevant de sa compétence.
In fine, le modèle proposé par le Maroc s’inscrit dans le cadre du choix stratégique adopté par le pays en faveur de la consécration des valeurs de la démocratie locale et du développement socioéconomique et humain intégré.
Aboutissement d’un long processus de décentralisation initié au Maroc au lendemain de l’indépendance, la régionalisation avancée constitue un choix stratégique irréversible qui met le citoyen au centre des préoccupations de l’Etat. Elle constitue un tournant majeur dans les modes de gouvernance territoriale au Maroc. Le projet de la régionalisation avancée vise à renforcer la représentativité des citoyens dans les conseils régionaux et à mettre en place des mécanismes à même d’instaurer une véritable démocratie participative. Cette dernière ne se limite nullement au droit de vote prévu périodiquement, mais elle désigne les dispositifs juridiques et institutionnels permettant d’impliquer les citoyens dans la gestion des affaires locales et, par conséquent, d’influer sur le processus de prise de décision au niveau de la région.
En ce sens, il convient de souligner que la démocratie participative est envisagée dans le cadre de la régionalisation avancée à deux niveaux. Il s’agit tout d’abord, d’une participation directe des citoyens, et ensuite d’une participation du tissu associatif. Le premier niveau se traduit par l’implication directe des citoyens dans le choix de leurs représentants dans les instances élues. Le second niveau appréhende le tissu associatif comme une véritable force de proposition, de veille et d’interpellation auprès des instances élues. En outre, ces acteurs associatifs participeront à la promotion de la culture de la démocratie locale et à la réalisation de projets de développement régionaux.
Mais cette implication passe par un renforcement des capacités de ces associations et par la mise à leur disposition des moyens matériels nécessaires. De plus, la CCR préconise l’adoption de dispositifs consultatifs qui permettront d’organiser l’expression des besoins et des attentes des citoyens en ce qui concerne les questions qui affectent leur vie quotidienne. Ainsi, un mécanisme de dialogue et de concertation avec le tissu associatif sera mis en place dans la perspective d’optimiser sa participation dans le processus de prise de décision au niveau régional. De surcroît, un cadre de référence définissant les principes, conditions et modalités de partenariat avec les associations a été mis en place par la CCR. Il faut ajouter que l’implication des forces sociales dans la gestion des affaires locales ne se limite pas seulement à la participation dans le processus de prise de décision mais se traduit également par l’exercice d’un droit de pétition. Ce dernier constitue un véritable contrôle populaire sur les conseils régionaux. Ce droit de pétition permet aux citoyens d’inscrire à l’ordre du jour du conseil, une question relevant de sa compétence.
In fine, le modèle proposé par le Maroc s’inscrit dans le cadre du choix stratégique adopté par le pays en faveur de la consécration des valeurs de la démocratie locale et du développement socioéconomique et humain intégré.

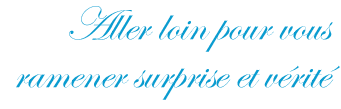







 Accueil
Accueil Actus
Actus
















